En tenant compte de la baisse d'audience que notre blog rencontre, vu le désordre qui a causé cette faillite, l'équipe de Serge Gainsboug décide de réaménager son blog. Tout d'abord, nous vous prions d'être régulier, car nous débuterons à partir du Lundi 5 janvier, le nouveau emploie du temps du Blog.
Cet emploie du temps sera disponible, bientôt, restez à l'écoute.
Nos objectifs, c'est de faire de vous des vainqueurs en milieux scolaire. Nous voulions que vous ayez un minium de confiance en vous lors de vos devoirs et interrogations (encore moins au BAC). En effet, ceux qui trichent ne sont pas tous idiots, comme nous le pensons, mais il faudra reconnaître que c'est parce qu'ils n'ont pas suffisamment confiance qu'ils réussiront, ou peut-être qu'ils sont paresseux.
Bref, avec nous, vous pouvez dire à Dieu à la paresse.
samedi 13 décembre 2014
vendredi 28 novembre 2014
Le Commentaire de Texte philosophique en vidéo
Première partie
Deuxième parie
Troisième partie
Merci et bonne révision à toi ! Et je te conseil d'essayé de rédiger toi-même une bonne rédaction.
Deuxième parie
Troisième partie
Merci et bonne révision à toi ! Et je te conseil d'essayé de rédiger toi-même une bonne rédaction.
jeudi 20 novembre 2014
Equation du premier degré à une inconnue
Soyez attentive au cours, prenez votre stylo et refaites SVP l'exercice proposer dans cette vidéo.
Ne pensez jamais que vous ne pouvez pas y arriver. Donnez-vous toujours les moyens d'atteindre vos objectifs
Cours netprof.fr de Philosophie / Terminale
Ne pensez jamais que vous ne pouvez pas y arriver. Donnez-vous toujours les moyens d'atteindre vos objectifs
Cours netprof.fr de Philosophie / Terminale
mardi 18 novembre 2014
Explication de texte en vidéo
Merci de bien suivre attentivement la première vidéo avant de passer à la deuxième
Explication de texte : théorie
Explication de texte : pratique
Cours netprof.fr de Philosophie / Terminale
vendredi 14 novembre 2014
10 conseils pour une année scolaire réussie
Ça y est, tout le monde a repris le chemin de l’école ! voici 10 conseils pratiques pour réussir votre année scolaire

Conseil n°1
Ayez un sommeil régulier. Un sommeil de bonne durée et de bonne qualité a un impact positif sur les capacités physiques et intellectuelles.
Conseil n°2
Adoptez une bonne hygiène alimentaire. Une alimentation saine et équilibrée a un effet positif sur la santé, tout en vous permettant d’utiliser au maximum toutes vos facultés.
Conseil n°3
organisez votre travail, apprenez à anticiper en gérant votre temps. N'attendez pas le dernier moment pour faire vos exercices ou pour commencer le devoir que vous devez rendre le lendemain.
Conseil n°4
Fixer vous des objectifs (ex: consacrer une à deux heures par jour à votre travail de classe)
Conseil n°5
Adoptez une méthode de travail efficace. Relisez systématiquement vos cours, refaites les exercices donnés en classe. Révisez vos leçons régulièrement cela vous permettra de stimuler votre mémoire.
Conseil n°6
Apprenez à prendre des notes
Conseil n°7
Limitez les distractions numériques (jeux vidéos, téléphone mobile, ordinateur, musique).
Conseil n°8
Préparez votre matériel ainsi que vos vêtements la veille au soir.
Conseil n°9
Pratiquez une activité physique régulière.
Conseil n°10
Soyez assidu et attentif à tous les cours.
Pour mettre tous ses conseils en pratique, clique ici pour suivre un cours de philosophie en vidéo
dimanche 9 novembre 2014
Cours de Math sur les Nombres complexes
Voici 6 vidéos cours sur les Nombres Complexes
.....................................1e partie.....................................2e partie
.....................................3e partie
.....................................4e partie
.....................................5e partie
.....................................6e partie
Sans la pratique, les maths peuvent être sincèrement ennuyant. Les Nombres Complexes ont eu une malchance à être appelé comme ça, d'abord "Complexe" ressemble à "Compliqué" même si c'est un peu vrai. Mais si on dit que c'est compliqué, personne ne sera motivé à l'apprendre.
Donc, oublier le nom complexe. Considérons que se sont des nombres "Super", ou "Supra", ou peu importe le nom que vous voulez, la clef de la réussite, c'est le travail. Regardez bien les vidéos et essayez vous même les exemples.
Merci d'avance!
dimanche 19 octobre 2014
BACCALAUREAT 2014 :
séries A1 & A2
Sujet 1 : Le bonheur est-il accessible à l'homme ?
Sujet 2 : Doit-on surestimer la science ?
Sujet 3 : Dégagez l'intérêt philosophique de ce texte à partir de son étude ordonnée.
La discipline transforme l'animalité en humanité. Par son instinct un animal est déjà tout ce qu'il peut être, une raison étrangère a déjé pris soin de tout pour lui. Mais l'homme doit user de sa propre raison. Il n'a point d'instinct et doit fixer lui-même le plan de sa conduite. Or, puisqu'il n'est pas immédiatement capable de le faire, mais au contraire vient au monde pour ainsi dire à l'état brut, il faut que d'autres le fassent pour lui. (...)
La discipline empêche que l'homme soit détourné de sa destination, celle de l'humanité, par ses penchants animaux. Elle doit par exemple lui imposer des bornes, de telle sorte qu'il ne se précipite pas dans les dangers sauvagement et sans réflexion. La discipline est ainsi simplement négative ; c'est l'acte par lequel on dépouille l'homme de son animalité ; en revanche l'instruction est la partie positive de l'éducation.
L'état sauvage est l'indépendance envers les lois. La discipline soumet l'homme aux lois de l'humanité et commence à lui faire sentir la contrainte des lois. Mais cela doit avoir lieu de bonne heure. C'est ainsi par exemple que l'on envoie tout d'abord les enfants à l'école non dans l'intention qu'ils y apprennent quelque chose, mais afin qu'ils s'habituent à demeurer tranquillement assis et à observer ponctuellement ce qu'on leur ordonne, en sorte que par la suite ils puissent ne pas mettre réellement et sur-le-champ leurs idées à exécution.
E. Kant, Traité de pédagogie
dimanche 28 septembre 2014
Réussir la dissertation de philosophie
Bien lire le sujet
Le piège d'un sujet de philosophie, c'est souvent
son caractère anodin, presque trop simple : parfois, on pourrait presque
vouloir répondre par oui ou par non. Il faut se méfier, car le premier
objet de la dissertation de philosophie, ce n'est pas la réponse à la
question posée, c'est la question elle-même. La première tâche, en
lisant un sujet, c'est donc de voir tout ce qu'il a de complexité
cachée, tous les problèmes qu'il recèle, et surtout pourquoi aucune
réponse simple ne peut lui être apportée. Ainsi, Pau est-il au nord de
Lille ? n'est (en principe) pas un sujet de philosophie, car on peut
trouver la réponse en consultant une carte. La lecture du sujet, des
différents termes, doit ainsi aboutir à une problématique : la
problématique est une forme d'incertitude, de conflit entre deux thèses
qui apparaissent également fondées, et qui pourtant ne sont pas
compatibles. La meilleure image que l'on peut donner d'une
problématique, c'est l'illusion d'optique : dans une illusion d'optique,
on a à la fois une illusion (le bâton plongé dans l'eau a l'air brisé)
et la conscience que c'est une illusion (quand on le sort de l'eau, on
voit bien qu'il n'est pas brisé) : il faut arriver à comprendre comment
le bâton peut avoir l'air brisé sans être brisé.
La première partie de nos fiches téléchargeables comporte
toujours une analyse du sujet, qui vise à faire ressortir la
problématique. Il n'y a bien sûr pas qu'une seule problématique
possible.
Exemple (tiré de nos fiches téléchargeables) : "Que nous apprend l'histoire ?"
"Le problème de ce sujet sera de dépasser l'évidence selon laquelle « apprendre l'histoire » signifie assimiler les informations permettant de retracer le cours des évènements dans le temps. En effet, la question « que nous apprend l'histoire ? » semble indiquer que selon le sens de l'histoire que l'on privilégie, il se joue plus qu'une simple transmission d'informations, c'est-à-dire que l'histoire nous permet de raisonner et de former notre pensée critique pour interroger notre façon de percevoir et de comprendre le monde qui nous entoure..."
"Le problème de ce sujet sera de dépasser l'évidence selon laquelle « apprendre l'histoire » signifie assimiler les informations permettant de retracer le cours des évènements dans le temps. En effet, la question « que nous apprend l'histoire ? » semble indiquer que selon le sens de l'histoire que l'on privilégie, il se joue plus qu'une simple transmission d'informations, c'est-à-dire que l'histoire nous permet de raisonner et de former notre pensée critique pour interroger notre façon de percevoir et de comprendre le monde qui nous entoure..."
Le plan ? oui, mais après la problématique
La dissertation est un exercice de méthode et d'argumentation : le plan
que vous allez choisir est donc capital car il doit témoigner de votre
démarche de réflexion. Évitez cependant de commencer votre travail par
chercher le plan, et de croire qu'il est achevé quand vous le tenez. Le
plan doit en effet se déduire de la problématique : si elle vous manque,
impossible de construire un plan efficace.
Nos fiches téléchargeables comportent toutes un plan (détaillé
ou rédigé) qui correspond à l'analyse du sujet que nous proposons / le
choix d'une problématique différente pourrait imposer un autre plan.
Traditionnellement, le plan se compose de trois parties. Thèse,
antithèse, foutaise ? Si pour vous thèse-antithèse-synthèse, cela veut
dire un plan oui/non/peut-être, en effet, vous risquez de rater votre
dissertation. Le principe est plutôt de discuter dans chacune des deux
premières parties une thèse en montrant à la fois sa force et ses
limites ; la dernière partie doit apporter une synthèse, une
réconciliation de ces points de vue également valables mais limités, en
choisissant une perspective
Exemple de plan proposé par philofacile.com (tiré de nos fiches téléchargeables) : "Que nous apprend l'histoire?"
"1)
a. Si l'histoire est une juxtaposition d'évènements, apprendre l'histoire signifie apprendre une chronologie d'évènements, c'est-à-dire savoir que ces événements ont eu lieu,
b.dans un certain ordre chronologique et linéaire
c. et entretiennent des rapports de causalité dans lesquels tous les évènements ont des degrés d'importance variables.
2) Mais cette réflexion sur la question de savoir comment définir des évènements importants conduit à montrer que l'histoire n'est jamais une pure donnée objective mais doit être interprétée et construite dans la masse des évènements. Cette remarque permet de montrer que l'histoire ne laisse pas aussi facilement comprendre comme une succession linéaire d'évènements.
a. Apprendre l'histoire nous apprend alors moins ce que nous avons été que ce que nous sommes, dans la mesure où l'ordre est toujours supposé. Nous sommes donc confrontés à une vérité historique relative,
b. qui nous oblige à critiquer nos propres méthodes de pensée
c. et nous conduit plus à supposer ce que nous avons été pour constater ce que nous sommes devenus..."
"1)
a. Si l'histoire est une juxtaposition d'évènements, apprendre l'histoire signifie apprendre une chronologie d'évènements, c'est-à-dire savoir que ces événements ont eu lieu,
b.dans un certain ordre chronologique et linéaire
c. et entretiennent des rapports de causalité dans lesquels tous les évènements ont des degrés d'importance variables.
2) Mais cette réflexion sur la question de savoir comment définir des évènements importants conduit à montrer que l'histoire n'est jamais une pure donnée objective mais doit être interprétée et construite dans la masse des évènements. Cette remarque permet de montrer que l'histoire ne laisse pas aussi facilement comprendre comme une succession linéaire d'évènements.
a. Apprendre l'histoire nous apprend alors moins ce que nous avons été que ce que nous sommes, dans la mesure où l'ordre est toujours supposé. Nous sommes donc confrontés à une vérité historique relative,
b. qui nous oblige à critiquer nos propres méthodes de pensée
c. et nous conduit plus à supposer ce que nous avons été pour constater ce que nous sommes devenus..."
Soignez l'introduction
L'introduction est le premier contact avec votre
correcteur : s'il est raté, il risque bien de ne pas vous lire avec la
même gentillesse ou tout simplement avec la même attention. Dans
l'introduction, vous devez a) motiver le sujet (c'est-à-dire montrer en
quoi il est nécessaire, urgent, capital de s'y plonger) et b)
problématiser (c'est-à-dire transformer l'énoncé en un problème
philosophique)...évitez donc d'en rester à un bavardage
pré-philosophique, histoire de garder les bonnes idées pour le
développement. Une introduction sans concept philosophique, sans
problème, sans tentative de définition
Évitezle recueil de citations
Beaucoup pensent qu'une bonne copie de philosophie,
c'est une copie qui cite les bons auteurs. Certes, la philosophie est
une discipline qui a ses champions, qu'on appelle sans originalité des
philosophes. Les connaître, c'est s'appuyer sur leur réflexion pour
éviter de tomber dans des banalités ou passer à côté d'une difficulté
essentielle : mais ce n'est pas pouvoir citer une quinzaine de mots de
chacun d'eux. La citation ne prouve jamais rien, or votre copie doit
démontrer. Et la citation ne prouve pas non plus que l'on connaisse
l'auteur. La seule chose que produit immanquablement une citation, c'est
un voyant d'alerte chez le correcteur, qui lui signale qu'on est en
train d'essayer de le séduire et de l'embobiner. Si la citation est mal
utilisée, si la pensée évoquée n'est pas précisée, le seul résultat sera
de l'irriter.
Voilà pourquoi nos fiches ne comportent pas de citations, mais des raisonnements : l'objet de la dissertation de philosophie est de penser un problème, et les citations ne sont ni nécessaires ni efficaces pour réussir.
Voilà pourquoi nos fiches ne comportent pas de citations, mais des raisonnements : l'objet de la dissertation de philosophie est de penser un problème, et les citations ne sont ni nécessaires ni efficaces pour réussir.
jeudi 25 septembre 2014
Un p'tit Quiz de vocabulaire
Le quizz est en train de charger depuis Quizity.com, le site pour créer un quiz, veuillez patienter...
mercredi 24 septembre 2014
Philosophons 2 La philosophie
Bonjour à toutes et à tous.
dans cette série de vidéo, vous aurez l'élément nécessaire pour comprendre ce qu'est la philosophie.
Il y a précisément 3 vidéos dans cette série qui vous permettra d'avoir une définition a priori de la philosophie.
Tu peux aussi lire le poème du vendredi passé clique sur Poème : Je t’aime la poésie
Je t’invite à visiter mon blog de séduction pour savoir comment draguer au festival des grillades clique sur :*
Je t’invite à visiter mon blog de séduction pour savoir comment draguer au festival des grillades clique sur :*
Besoin d'une baladeuse ? Tu as surement déjà entendu parlé des espadrilles clique sur Espadrilles pour passer ta commande.
Exercice N°2 : Démonstration avec deux variables.
On note  et
et  deux réels .
deux réels .
1. Démontrer que pour tout alors
alors 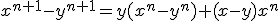 .
.
2. Exprimer en fonction de
en fonction de  , si k = n .
, si k = n .
3. Démontrer par récurrence que pour tout alors
alors  .
.
1. Démontrer que pour tout
2. Exprimer
3. Démontrer par récurrence que pour tout
lundi 22 septembre 2014
Les news du school
C'est la rentrée et nombreux sont les élèves qui sont retournés sur les bancs aujourd'hui.
Le sac bien remplir, le kaki repassé et fourré, sans oublier les paires de chaussure aux pieds. Le style idéal pour un beau gosse.
Bonne année scolaire et étudiez bien, car il n'y a que vous-même qui serez les plus heureux lorsque vous aurez de bon résultats.
Cliquez ici pour écouter Confession et Conseils en ligne !
Le sac bien remplir, le kaki repassé et fourré, sans oublier les paires de chaussure aux pieds. Le style idéal pour un beau gosse.
Bonne année scolaire et étudiez bien, car il n'y a que vous-même qui serez les plus heureux lorsque vous aurez de bon résultats.
Cliquez ici pour écouter Confession et Conseils en ligne !
dimanche 21 septembre 2014
Les repères philosophique
Absolu - Relatif
Absolu : ce qui ne dépend de rien d’extérieur à soi, qui ne dépend que de soi - renvoie à une indépendance, à une autosuffisance
Relatif : ce qui est en relation avec quelque chose d’autre, qui dépend de conditions extérieures à soi mêmes
Abstrait - Concret
Abstrait : ce qui est loin du concret, immatériel - n‘a pas de valeur en soi (ex : les idées)
Concret : ce qui est à portée de main, solide, qui renvoie à une réalité matérielle
En acte - En puissance
En acte : ce qui est actuellement, effectif à l’instant
En puissance : ce qui est potentiellement, virtuellement , ce qui tend à être
Analyse - Synthèse
Analyse : décomposer, mettre en morceaux
Synthèse : recomposer, mettre ensemble, rassembler
Cause - Fin
Cause : ce qui produit un phénomène, « à cause » de quoi cela est produit
Fin : ce en vue de quoi la chose est produite, son but, ce qu’elle vise
Contingent - Nécessaire
Contingent : ce qui peut ne pas être
Nécessaire : ce qui ne peut pas ne pas être
Croire - Savoir
Croire : avoir une représentation hypothétique du monde
Savoir : avoir une représentation vraie du monde, en sachant pourquoi elle est vraie
Essentiel - Accidentel
Essentiel : ce qui appartient à l’essence d’une chose, ce qui lui est nécessairement lié, ce qui appartient à sa définition, ce sans quoi la chose ne serait pas ce qu’elle est
Accidentel : ce qui appartient à une chose de manière contingente, qu’elle peut ne pas avoir tout en restant elle-même
Expliquer - Comprendre
Expliquer : rendre possible la compréhension de quelque chose
Comprendre : avoir une représentation claire du phénomène, possible par l’explication
En fait - En droit
En fait : ce qui est effectif actuellement
En droit : ce qui doit être, mais qui n’est pas nécessairement ou ne sera peut-être jamais
Formel - Matériel
Formel : c’est le cadre
Matériel : c’est le contenu, ce qui l’on met dans le cadre
Genre - Espèce - Individu
Genre : groupe général auquel appartient un individu
Espèce : sous-groupe, plus précis, permettant de resserrer la définition de cet individu
Individu : être qui est défini par ces deux termes
Idéal - Réel
Idéal : idée la plus parfaite que l’on se fait de quelque chose
Réel : ce qui existe dans les faits
Identité - Egalité - Différence
Identité : être identique : le fait d’être le même d’un point de vue qualitatif
Egalité : être égal : le fait d’être le même d’un point de vue quantitatif
Différence : différence quantitative ou qualitative
Intuitif - Discursif
Intuitif : mode d’appréhension directe du réel qui ne passe pas par le langage
Discursif : mode d’appréhension qui passe par le discours, donc par le langage et la raison
Légal - Légitime
Légal : ce qui est conforme à la loi
Légitime : ce qui est conforme à la justice, ce qui est reconnu comme devant être suivi
Médiat - Immédiat
Médiat : qui passe par quelque chose d’autre, par des moyens, pour atteindre son but
Immédiat : qui ne passe pas par des moyens, qui atteint son but directement
Objetif - Subjectif
Objectif : ce qui correspond à l’objet -> impartial, extérieur, indépendant des préférences du sujet
Subjectif : ce qui correspond au sujet -> partial, intérieur à soi, exprimant des préférences
Obligation - Contrainte
Obligation : ce qui nous pousse à agir en vue d’une nécessité extérieure, subjective, qui fait reconnaître un droit d’agir de cette manière-là.
Contrainte : ce qui nous pousse à agir contre notre volonté
Origine - Fondement
Origine : point de départ chronologique d’un processus
Fondement : point de départ logique
Persuader - Convaincre
Persuader : emporter l’adhésion de l’auditeur en faisant appel à ses émotions et à son imagination, sans que la chose soit forcément vraie
Convaincre : emporter l’adhésion grâce à des arguments rationnels, faire reconnaître la vérité de quelque chose par quelqu’un
Ressemblance - Analogie
Ressemblance : quand deux ou plusieurs choses ont une ou des propriétés communes qui leur donne des aspects semblables
Analogie : quand les choses ont une structure commune
Principe - Conséquence
Principe : point de départ d’une action, d’un raisonnement, d’un processus
Conséquence : ce qui découle de ce point de départ
En théorie - En pratique
En théorie : discours sur le monde -> explique le fonctionnement de l’un de ses aspects (relations de cause à effet des différents phénomènes)
En pratique : application de la théorie au réel, suppose parfois des écarts
Transcendant - Immanent
Transcendant : extérieur à la dimension humaine, au monde ; au-delà
Immanent : intérieur, au-dedans : appartient à la sphère humaine
Universel - Général - Particulier - Singulier
Universel : s’applique à tous les êtres sans exception
Général : s’applique à tous les êtres d’un groupe, admettant des exceptions
Particulier : ce à quoi s’applique le cas général
Singulier : ce à quoi aucun cas général ne peut s’appliquer
Absolu : ce qui ne dépend de rien d’extérieur à soi, qui ne dépend que de soi - renvoie à une indépendance, à une autosuffisance
Relatif : ce qui est en relation avec quelque chose d’autre, qui dépend de conditions extérieures à soi mêmes
Abstrait - Concret
Abstrait : ce qui est loin du concret, immatériel - n‘a pas de valeur en soi (ex : les idées)
Concret : ce qui est à portée de main, solide, qui renvoie à une réalité matérielle
En acte - En puissance
En acte : ce qui est actuellement, effectif à l’instant
En puissance : ce qui est potentiellement, virtuellement , ce qui tend à être
Analyse - Synthèse
Analyse : décomposer, mettre en morceaux
Synthèse : recomposer, mettre ensemble, rassembler
Cause - Fin
Cause : ce qui produit un phénomène, « à cause » de quoi cela est produit
Fin : ce en vue de quoi la chose est produite, son but, ce qu’elle vise
Contingent - Nécessaire
Contingent : ce qui peut ne pas être
Nécessaire : ce qui ne peut pas ne pas être
Croire - Savoir
Croire : avoir une représentation hypothétique du monde
Savoir : avoir une représentation vraie du monde, en sachant pourquoi elle est vraie
Essentiel - Accidentel
Essentiel : ce qui appartient à l’essence d’une chose, ce qui lui est nécessairement lié, ce qui appartient à sa définition, ce sans quoi la chose ne serait pas ce qu’elle est
Accidentel : ce qui appartient à une chose de manière contingente, qu’elle peut ne pas avoir tout en restant elle-même
Expliquer - Comprendre
Expliquer : rendre possible la compréhension de quelque chose
Comprendre : avoir une représentation claire du phénomène, possible par l’explication
En fait - En droit
En fait : ce qui est effectif actuellement
En droit : ce qui doit être, mais qui n’est pas nécessairement ou ne sera peut-être jamais
Formel - Matériel
Formel : c’est le cadre
Matériel : c’est le contenu, ce qui l’on met dans le cadre
Genre - Espèce - Individu
Genre : groupe général auquel appartient un individu
Espèce : sous-groupe, plus précis, permettant de resserrer la définition de cet individu
Individu : être qui est défini par ces deux termes
Idéal - Réel
Idéal : idée la plus parfaite que l’on se fait de quelque chose
Réel : ce qui existe dans les faits
Identité - Egalité - Différence
Identité : être identique : le fait d’être le même d’un point de vue qualitatif
Egalité : être égal : le fait d’être le même d’un point de vue quantitatif
Différence : différence quantitative ou qualitative
Intuitif - Discursif
Intuitif : mode d’appréhension directe du réel qui ne passe pas par le langage
Discursif : mode d’appréhension qui passe par le discours, donc par le langage et la raison
Légal - Légitime
Légal : ce qui est conforme à la loi
Légitime : ce qui est conforme à la justice, ce qui est reconnu comme devant être suivi
Médiat - Immédiat
Médiat : qui passe par quelque chose d’autre, par des moyens, pour atteindre son but
Immédiat : qui ne passe pas par des moyens, qui atteint son but directement
Objetif - Subjectif
Objectif : ce qui correspond à l’objet -> impartial, extérieur, indépendant des préférences du sujet
Subjectif : ce qui correspond au sujet -> partial, intérieur à soi, exprimant des préférences
Obligation - Contrainte
Obligation : ce qui nous pousse à agir en vue d’une nécessité extérieure, subjective, qui fait reconnaître un droit d’agir de cette manière-là.
Contrainte : ce qui nous pousse à agir contre notre volonté
Origine - Fondement
Origine : point de départ chronologique d’un processus
Fondement : point de départ logique
Persuader - Convaincre
Persuader : emporter l’adhésion de l’auditeur en faisant appel à ses émotions et à son imagination, sans que la chose soit forcément vraie
Convaincre : emporter l’adhésion grâce à des arguments rationnels, faire reconnaître la vérité de quelque chose par quelqu’un
Ressemblance - Analogie
Ressemblance : quand deux ou plusieurs choses ont une ou des propriétés communes qui leur donne des aspects semblables
Analogie : quand les choses ont une structure commune
Principe - Conséquence
Principe : point de départ d’une action, d’un raisonnement, d’un processus
Conséquence : ce qui découle de ce point de départ
En théorie - En pratique
En théorie : discours sur le monde -> explique le fonctionnement de l’un de ses aspects (relations de cause à effet des différents phénomènes)
En pratique : application de la théorie au réel, suppose parfois des écarts
Transcendant - Immanent
Transcendant : extérieur à la dimension humaine, au monde ; au-delà
Immanent : intérieur, au-dedans : appartient à la sphère humaine
Universel - Général - Particulier - Singulier
Universel : s’applique à tous les êtres sans exception
Général : s’applique à tous les êtres d’un groupe, admettant des exceptions
Particulier : ce à quoi s’applique le cas général
Singulier : ce à quoi aucun cas général ne peut s’appliquer
Du nouveau pour Confession et Conseil
Salut les gars, Confession et Conseil est en mode radio online cliquez ici pour l'écouter
samedi 20 septembre 2014
Les figures de style
Salut à toutes et à tous, je suis Jean Luc Doh, l'un des administrateurs. En fait ceci est mon premier article sur ce blog, vue qu'il ne m'appartient pas. Dans cet article, je veux vous parler des fameux "figures de style", parce qu'ils sont mal aimés sous prétexte que "c'est trop difficile", mais "difficile" n'est pas le mot convenable. Moi je dirait: "complexe".
Pour commencer les figures de style, très souvent utilisées dans le langage courant, rendent l’énoncé d’un texte plus expressif et plus vivant : le destinataire appréhende et imagine mieux ce que veut dire l’émetteur. LES FIGURES DE L’ANALOGIE
Ces figures créent des images en rapprochant deux univers différents.
* La comparaison établit un parallèle entre un premier terme (le comparé) et un deuxième terme (le comparant) par l’intermédiaire d’un outil grammatical qui peut être un verbe (ressembler à, avoir l’air, sembler, on eût dit), un adjectif (semblable, pareil à), un adverbe ou locution adverbiale (comme, ainsi que, de même que, plus que)… Le comparé et le comparant possèdent au moins une caractéristique commune qui justifie la comparaison.
Ex. Tu es belle comme le jour.
* La métaphore, comme la comparaison, unit un comparant et un comparé, mais sans outil de comparaison. Un mot est utilisé pour parler d’une réalité qu’il ne désigne pas habituellement. Il faut donc rechercher les raisons du rapprochement.
Ex. L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature.
* La personnification consiste à prêter des comportements ou des sentiments humains à un objet, à un être inanimé ou à un animal.
Ex. Ce souvenir dormait dans un coin de ma mémoire / Le cadavre d’un amour.
* L’allégorie est une personnification à laquelle on ajoute une valeur symbolique. Elle rend concrète une chose abstraite.
Ex. La mort est représentée par une faucheuse.
LES FIGURES DE SUBSTITUTION
Ici, on remplace un mot par un autre mot ou une expression inattendue.
* La métonymie désigne un élément par un terme entretenant avec cet élément une relation logique, comme le contenant pour le contenu, la cause pour l’effet, la marque pour l’objet…
Ex. Aimer la bouteille (pour « aimer le vin »), Vivre de son travail (pour « vivre de l’argent qu’on gagne en travaillant »).
* La synecdoque, variété de métonymie, désigne, pour parler d’un être ou d’un objet, une partie de celui-ci, ou au contraire, prend le tout pour la partie.
Ex. Un bronze (pour « une statue de bronze »), une voile (pour « un navire »)
* La périphrase remplace un terme par une expression plus développée qui le définit.
Ex. La capitale de la France (pour « Paris »)
* L’antiphrase dit, souvent par ironie, le contraire de ce qui est explicitement dit.
Ex. Quelle belle journée ! (alors qu’il pleut)
* L’antonomase consiste à transformer un nom propre en nom commun.
Ex. Un Harpagon (pour « un avare »), un Don Juan (pour « un séducteur »).
LES FIGURES D’INSISTANCE
Ces figures permettent la répétition et mettent en évidence une idée obsessionnelle dont elles
renforcent l’intensité.
* Le parallélisme utilise une même construction pour deux énoncés, de façon à mettre en évidence une similitude ou une opposition.
Ex. Partir pour tout laisser
Quitter pour tout abandonner
Revenir pour tout recommencer (infinitif + pour tout)
* L’anaphore est la répétition d’un mot ou d’une phrase en début de phrase, de proposition ou de vers.
Ex: Marcher à jeun, marcher vaincu, marcher malade.
* La gradation compose une succession de mots de sens proche, classés dans un ordre croissant d’intensité.
Ex: Va, cours, vole, et nous venge.
LES FIGURES D’OPPOSITION
Elles permettent de mettre en évidence ce qu’il y a d’opposé ou de contradictoire entre deux situations.
* L’antithèse souligne une opposition forte entre deux termes dans une phrase.
Ex. Certains aiment la nuit comme d'autres vénèrent le jour.
* L’oxymore est la réunion, dans une même expression, de deux termes contradictoires.
Ex. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles / Un mort-vivant
* Le chiasme croise des termes mis en opposition ou en parallèle, et renforce l’idée ainsi exprimée.
Ex. La neige (1) fait au nord (2) ce qu'au sud (2) fait le sable (1)
Ex. Il faut manger (1) pour vivre (2) et non pas vivre (2) pour manger (1)
LES FIGURES D’AMPLIFICATION OU D’ATTÉNUATION
L’amplification exprime l’exagération, alors que l’atténuation minimise la réalité.
* L’hyperbole emploie des termes exagérés.
Ex. Briller de mille feux / mourir de soif / avoir trois tonnes de travail…
* La litote consiste à dire le moins pour suggérer le plus. On feint d’atténuer une vérité que l’on affirme implicitement avec force. Le verbe est généralement à la forme négative.
Ex. Au piano, elle n'est pas très douée…(pour « elle est mauvaise »)
Ex. Ce garçon-là n’est pas sot (pour « il est intelligent »)
* L’euphémisme établit une atténuation, atténue la réalité pour ne pas choquer. On l’utilise le plus souvent pour évoquer des tabous : besoins naturels, maladie, sexe, mort…
Ex. Elle a vécu / (pour « elle est morte »)
Ex. Je répandis la terre du sommeil sur son corps (pour « je l’ai enterrée »)
Le Français
Le Français
La langue de molière est la plus belle et la plus facile à retenir. Bien vrai que nous nous laissons souvent planter par des fautes d'orthographes,de grammaires de conjugaison et souvent même de vocabulaires. Cette rubrique nous aidera donc à nous corriger et à combler certaine lacune.
Nous vous proposerons donc des conseils,des sujets et aussi des vidéos pour mieux atteindre notre objectif.Merci et à très bientôt.
La langue de molière est la plus belle et la plus facile à retenir. Bien vrai que nous nous laissons souvent planter par des fautes d'orthographes,de grammaires de conjugaison et souvent même de vocabulaires. Cette rubrique nous aidera donc à nous corriger et à combler certaine lacune.
Nous vous proposerons donc des conseils,des sujets et aussi des vidéos pour mieux atteindre notre objectif.Merci et à très bientôt.
Tu peux aussi lire le poème du vendredi passé clique sur Poème : Je t’aime la poésie
Je t’invite à visiter mon blog de séduction pour savoir comment draguer au festival des grillades clique sur :*
Je t’invite à visiter mon blog de séduction pour savoir comment draguer au festival des grillades clique sur :*
Besoin d'une baladeuse ? Tu as surement déjà entendu parlé des espadrilles clique sur Espadrilles pour passer ta commande.
vendredi 17 janvier 2014
Définition de la philosophie
-[Définition de la philosophie]-
Le mot « philosophie » (du grec ancien φιλοσοφία - composé de φιλεῖν : « aimer », et de σοφία : 1. habileté manuelle ; 2. savoir, science ; 3. sagesse pratique ; d'où : 1. sagesse [en général] ; 2. habileté, ruse [en mauvaise part] ; donc, « la sagesse » -, c'est-à-dire littéralement : « l'amour de la sagesse ») désigne une activité et une discipline existant depuis l'Antiquité en Occident et se présentant comme un questionnement, une interprétation et une réflexion sur le monde et l'existence humaine, ou encore comme un savoir systématique. Différents buts peuvent lui être attribués, de la recherche de la vérité, et de la méditation sur le bien et le beau, à celle du sens de la vie, et du bonheur, mais elle consiste plus largement dans l'exercice systématique de la pensée et de la réflexion. Ancrée dès ses origines dans le dialogue et le débat d'idées, la philosophie peut également se concevoir comme une activité d'analyse, de définition, de création ou de méditation sur des concepts.
À la différence des sciences naturelles, des sciences formelles et des sciences humaines, auxquelles elle est intimement liée par son histoire, la philosophie ne se donne pas un objet d'étude particulier et unique. On trouve toutefois au sein de la philosophie des domaines d'étude distincts, tels la logique, l’éthique, la métaphysique, la philosophie politique et la théorie de la connaissance. Au cours de l’histoire, d’autres disciplines se sont jointes à ces branches fondamentales de la philosophie, comme l’esthétique, la philosophie du droit, la philosophie des sciences (appelée aussi épistémologie), la philosophie de l'esprit, l’anthropologie philosophique, ou la philosophie du langage.
Tu peux aussi visiter ce blog se sport que j'aime bien: http://footballover5.blogspot.com/
Le mot « philosophie » (du grec ancien φιλοσοφία - composé de φιλεῖν : « aimer », et de σοφία : 1. habileté manuelle ; 2. savoir, science ; 3. sagesse pratique ; d'où : 1. sagesse [en général] ; 2. habileté, ruse [en mauvaise part] ; donc, « la sagesse » -, c'est-à-dire littéralement : « l'amour de la sagesse ») désigne une activité et une discipline existant depuis l'Antiquité en Occident et se présentant comme un questionnement, une interprétation et une réflexion sur le monde et l'existence humaine, ou encore comme un savoir systématique. Différents buts peuvent lui être attribués, de la recherche de la vérité, et de la méditation sur le bien et le beau, à celle du sens de la vie, et du bonheur, mais elle consiste plus largement dans l'exercice systématique de la pensée et de la réflexion. Ancrée dès ses origines dans le dialogue et le débat d'idées, la philosophie peut également se concevoir comme une activité d'analyse, de définition, de création ou de méditation sur des concepts.
À la différence des sciences naturelles, des sciences formelles et des sciences humaines, auxquelles elle est intimement liée par son histoire, la philosophie ne se donne pas un objet d'étude particulier et unique. On trouve toutefois au sein de la philosophie des domaines d'étude distincts, tels la logique, l’éthique, la métaphysique, la philosophie politique et la théorie de la connaissance. Au cours de l’histoire, d’autres disciplines se sont jointes à ces branches fondamentales de la philosophie, comme l’esthétique, la philosophie du droit, la philosophie des sciences (appelée aussi épistémologie), la philosophie de l'esprit, l’anthropologie philosophique, ou la philosophie du langage.
Tu peux aussi visiter ce blog se sport que j'aime bien: http://footballover5.blogspot.com/
Définition de la Physique
-[Définition de la Physique]-
La physique est la science qui tente de comprendre, modéliser voire expliquer les phénomènes physiques du monde (de l'univers). Elle correspond à l'étude du monde extérieur, des lois de sa variation et de son évolution. La modélisation des systèmes laisse de côté les processus chimiques et biologiques. La physique développe des représentations du monde vérifiables, applicables et appliquées dans un domaine de définition donné. La physique produit donc plusieurs lectures du monde, chacune n'étant considérée comme vraie que jusqu'à un certain point. La physique telle que conceptualisée par Isaac Newton, considérée comme le modèle absolu et aujourd’hui désignée comme la physique classique, n'arrivait pas à expliquer des phénomènes physiques comme, par exemple, le rayonnement du corps noir (Catastrophe ultraviolette) ou les anomalies de l’orbite de la planète mercure, ce qui posait un réel problème aux physiciens. Les tentatives effectuées pour comprendre et modéliser les phénomènes nouveaux auxquels on accédait à la fin du XIXe siècle révisèrent en profondeur le modèle newtonien pour donner naissance à deux nouveaux ensembles de théories physiques. Il existe donc trois ensembles de théories physiques établies, chacune valide dans le domaine d’applications qui lui est propre :
Les divisions anciennes en mécanique, calorique, acoustique, optique, électricité, magnétisme sont complétées ou remplacées par :
Le mot physique a une longue histoire, il provient de φυσικη, formée sur l'étymon grec φυσις, la nature. La physika ou physica gréco-romaine est étymologiquement ce qui se rapporte à la nature ou précisément le savoir harmonieux et cyclique sur la nature dénommée φυσις. Dans un sens général et ancien, la physique désigne la connaissance de la nature qui se perpétue en restant essentiellement la même avec le retour des saisons ou des générations vivantes ; c'est le sens de René Descartes et de ses élèves Jacques Rohault et Régis1. Elle correspond alors aux sciences naturelles ou encore à la philosophie naturelle. La signification de cette physique ancienne ne convient plus aux actuelles sciences exactes que sont la physique, la chimie et la biologie, cette dernière étant la plus tardive héritière directe des sciences naturelles2.
Tu peux aussi visiter ce blog de sport que j'aime bien: http://footballover5.blogspot.com/
La physique est la science qui tente de comprendre, modéliser voire expliquer les phénomènes physiques du monde (de l'univers). Elle correspond à l'étude du monde extérieur, des lois de sa variation et de son évolution. La modélisation des systèmes laisse de côté les processus chimiques et biologiques. La physique développe des représentations du monde vérifiables, applicables et appliquées dans un domaine de définition donné. La physique produit donc plusieurs lectures du monde, chacune n'étant considérée comme vraie que jusqu'à un certain point. La physique telle que conceptualisée par Isaac Newton, considérée comme le modèle absolu et aujourd’hui désignée comme la physique classique, n'arrivait pas à expliquer des phénomènes physiques comme, par exemple, le rayonnement du corps noir (Catastrophe ultraviolette) ou les anomalies de l’orbite de la planète mercure, ce qui posait un réel problème aux physiciens. Les tentatives effectuées pour comprendre et modéliser les phénomènes nouveaux auxquels on accédait à la fin du XIXe siècle révisèrent en profondeur le modèle newtonien pour donner naissance à deux nouveaux ensembles de théories physiques. Il existe donc trois ensembles de théories physiques établies, chacune valide dans le domaine d’applications qui lui est propre :
- La physique classique (monde des milieux solides, liquides et gazeux), toujours d'actualité, c'est elle qui s’applique, par exemple, à la construction des routes, des ponts et des avions. Elle utilise les anciennes notions de temps, d'espace, de matière et d'énergie telles que définies par Isaac Newton ;
- La physique quantique (monde microscopique des particules et des champs) qui s’applique, par exemple, à la technologie utilisée pour la production des composants électroniques, la construction des lecteurs de DVD et aux LASER. Elle se fonde sur de nouvelles définitions de l'énergie et de la matière mais conserve les anciennes notions de temps et d'espace de la physique classique, ces deux dernières étant contredites par la relativité générale. La physique quantique n'a jamais été prise en défaut à ce jour ;
- La relativité générale (monde macroscopique des planètes, des trous noir et de la gravité) qui s’applique, par exemple, à la mise au point et au traitement de l'information nécessaire au fonctionnement des systèmes GPS (global positioning system). Elle se fonde sur de nouvelles définitions du temps et de l'espace mais conserve les anciennes notions d'énergie et de matière de la physique classique, ces deux dernières étant contredites par la physique quantique. La relativité générale n'a jamais été prise en défaut à ce jour.
Les divisions anciennes en mécanique, calorique, acoustique, optique, électricité, magnétisme sont complétées ou remplacées par :
- la taille des éléments de structure au centre de la modélisation : particules élémentaires, noyaux atomiques, atomes, molécules, macromolécules ou polymères, grains de matière…
- les caractères des interactions à l'origine des phases ou états de la matière : plasma, gaz, liquide, solide.
- soit la vitesse est très inférieure à la célérité de la lumière dans le vide ;
- soit la discontinuité des niveaux d'énergie est impossible à mettre en évidence.
Le mot physique a une longue histoire, il provient de φυσικη, formée sur l'étymon grec φυσις, la nature. La physika ou physica gréco-romaine est étymologiquement ce qui se rapporte à la nature ou précisément le savoir harmonieux et cyclique sur la nature dénommée φυσις. Dans un sens général et ancien, la physique désigne la connaissance de la nature qui se perpétue en restant essentiellement la même avec le retour des saisons ou des générations vivantes ; c'est le sens de René Descartes et de ses élèves Jacques Rohault et Régis1. Elle correspond alors aux sciences naturelles ou encore à la philosophie naturelle. La signification de cette physique ancienne ne convient plus aux actuelles sciences exactes que sont la physique, la chimie et la biologie, cette dernière étant la plus tardive héritière directe des sciences naturelles2.
Tu peux aussi visiter ce blog de sport que j'aime bien: http://footballover5.blogspot.com/
Définition des Mathématiques
-[Définition des Mathématiques]-
Les mathématiques sont un ensemble de connaissances abstraites résultant de raisonnements logiques appliqués à divers objets tels que les nombres, les figures, les structures et les transformations. Les mathématiques sont aussi le domaine de recherche développant ces connaissances, ainsi que la discipline qui les enseigne.
Les mathématiques se distinguent des autres sciences par un rapport particulier au réel. Elles sont de nature entièrement intellectuelle, étant fondées sur des axiomes déclarés vrais (c'est-à-dire que les axiomes ne sont pas soumis à l'expérience, même s'ils en sont souvent inspirés) ou sur des postulats provisoirement admis. Un énoncé mathématique – dénommé généralement, après être validé, théorème, proposition, lemme, fait, scholie ou corollaire – est considéré comme valide lorsque le discours formel qui établit sa vérité respecte une certaine structure rationnelle appelée démonstration, ou raisonnement logico-déductif. Un énoncé plausible, mais qui n'a pas encore été ainsi établi comme vrai, s'appelle une conjecture.
Bien que les résultats mathématiques soient des vérités purement formelles, ils trouvent cependant des applications dans les autres sciences et dans différents domaines de la technique. C'est ainsi qu'Eugene Wigner parle de « la déraisonnable efficacité des mathématiques dans les sciences de la nature » .
Tu peux aussi visiter ce blog se sport que j'aime bien: http://footballover5.blogspot.com/
Les mathématiques sont un ensemble de connaissances abstraites résultant de raisonnements logiques appliqués à divers objets tels que les nombres, les figures, les structures et les transformations. Les mathématiques sont aussi le domaine de recherche développant ces connaissances, ainsi que la discipline qui les enseigne.
Les mathématiques se distinguent des autres sciences par un rapport particulier au réel. Elles sont de nature entièrement intellectuelle, étant fondées sur des axiomes déclarés vrais (c'est-à-dire que les axiomes ne sont pas soumis à l'expérience, même s'ils en sont souvent inspirés) ou sur des postulats provisoirement admis. Un énoncé mathématique – dénommé généralement, après être validé, théorème, proposition, lemme, fait, scholie ou corollaire – est considéré comme valide lorsque le discours formel qui établit sa vérité respecte une certaine structure rationnelle appelée démonstration, ou raisonnement logico-déductif. Un énoncé plausible, mais qui n'a pas encore été ainsi établi comme vrai, s'appelle une conjecture.
Bien que les résultats mathématiques soient des vérités purement formelles, ils trouvent cependant des applications dans les autres sciences et dans différents domaines de la technique. C'est ainsi qu'Eugene Wigner parle de « la déraisonnable efficacité des mathématiques dans les sciences de la nature » .
Tu peux aussi visiter ce blog se sport que j'aime bien: http://footballover5.blogspot.com/
mardi 7 janvier 2014
Le secret de la semaine
-[Top secret]-
Le meilleur élève n'est pas le plus intelligent mais le plus courageux...
visite aussi mon blog d'amour :http://confessionetconseil.blogspot.com/
Le meilleur élève n'est pas le plus intelligent mais le plus courageux...
visite aussi mon blog d'amour :http://confessionetconseil.blogspot.com/
Inscription à :
Articles (Atom)




